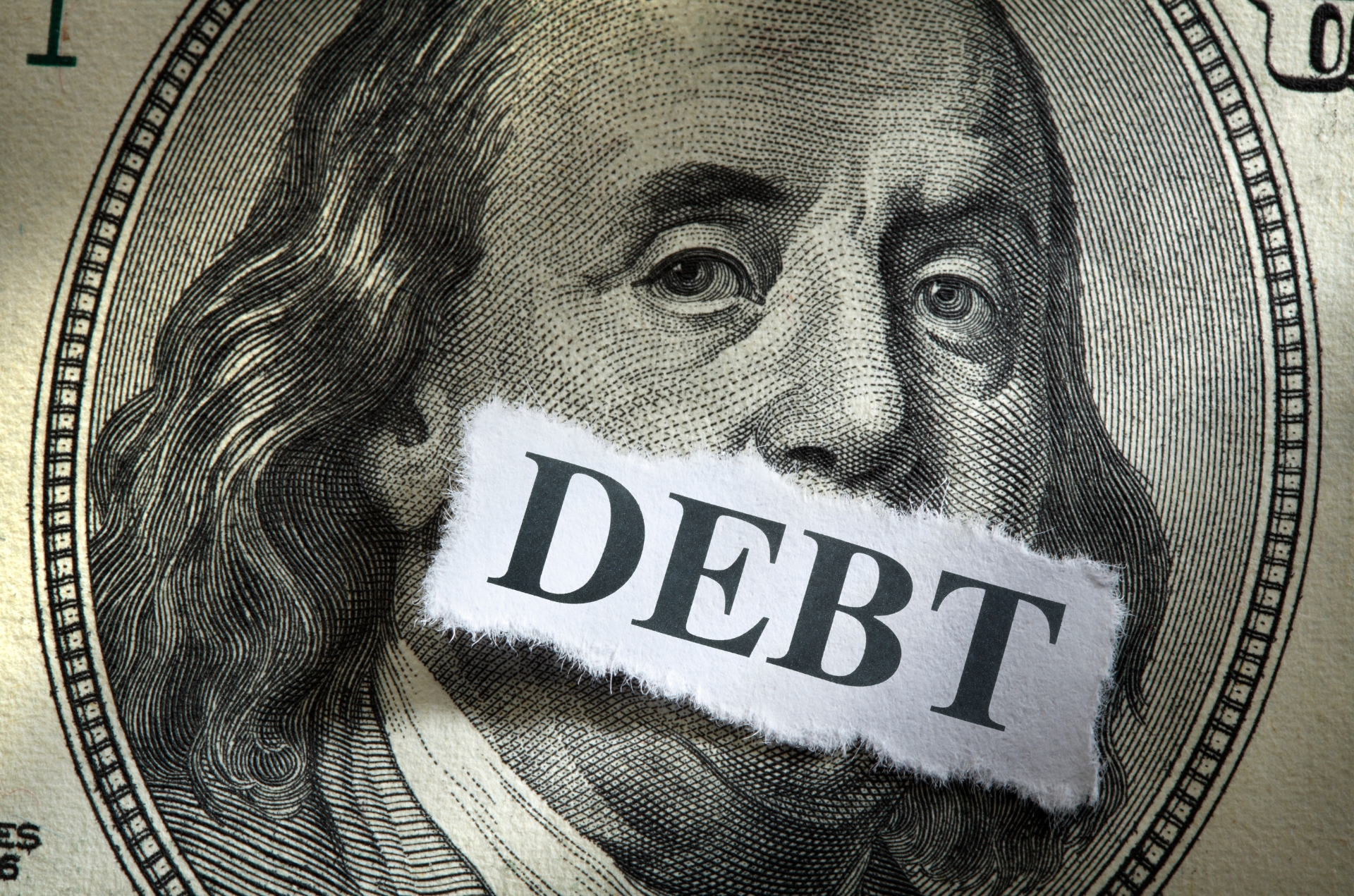Et si les stablecoins sauvaient la dette américaine ?
La dette publique des États-Unis atteint des sommets vertigineux. En 2024, elle frôle les 36 000 milliards de dollars, soit près de 120 % du PIB américain. Pour financer ce gouffre financier, l’État fédéral emprunte sans cesse davantage, alimentant un cercle vicieux d’endettement. Ces dernières années, les alertes se multiplient : en août 2023, l’agence Fitch a retiré aux États-Unis leur prestigieux « AAA » en raison des impasses répétées autour du plafond de la dette et d’une trajectoire budgétaire jugée inquiétante. Fitch anticipe un creusement du déficit fédéral avec une dette approchant 118 % du PIB d’ici 2025. Autrement dit, même la première économie mondiale voit sa crédibilité financière ternie. L’ombre d’un possible défaut de paiement plane à chaque psychodrame politique sur le relèvement du plafond de la dette, car démocrates et républicains peinent à s’accorder sur la maîtrise des dépenses (et c’est le cas le jour où j’écris ces lignes). Certes, jusqu’ici la catastrophe a été évitée de justesse, mais la confiance s’érode : jusqu’à quand les créanciers continueront-ils de financer sans sourciller l’appétit insatiable de Washington ?
Une hégémonie financière en déclin
La dette colossale des États-Unis n’est pas qu’un problème comptable interne, elle menace aussi l’hégémonie financière américaine bâtie sur le dollar. Depuis l’après-guerre, le dollar est la monnaie de référence mondiale. Ce statut de devise de réserve confère aux États-Unis un privilège exorbitant : celui de pouvoir creuser leurs déficits en étant assurés que le reste du monde continuera à acheter des dollars et des bons du Trésor américain. Tant que banques centrales, gouvernements et investisseurs étrangers considèrent le dollar comme une valeur sûre, les États-Unis peuvent vivre au-dessus de leurs moyens sans subir de sanction immédiate. Mais ce privilège repose sur la confiance, une confiance qui s’étiole peu à peu.
Plusieurs indicateurs témoignent d’un lent déclin de la domination du dollar. La part du dollar dans les réserves de change mondiales est passée d’environ 70 % au début des années 2000 à seulement 58 % aujourd’hui. En parallèle, de grandes puissances comme la Chine, la Russie ou les pays du Golfe orchestrent une dé-dollarisation progressive de leurs échanges. Pékin et Moscou, par exemple, règlent désormais l’essentiel de leur commerce bilatéral en yuan ou en rouble plutôt qu’en dollars. Des blocs comme les BRICS discutent ouvertement de la création d’une devise alternative pour réduire leur dépendance au billet vert. Ces évolutions, inimaginables il y a encore vingt ans, signalent que l’hégémonie du dollar n’est plus intouchable.
Les causes de cette remise en cause sont multiples. D’une part, les sanctions financières occidentales, notamment contre la Russie, ont poussé certains États à chercher des systèmes de paiement contournant le dollar et le réseau SWIFT. D’autre part, la gestion jugée imprudente des finances américaines alarme les partenaires étrangers : pourquoi accumuler des bons du Trésor libellés en dollars si leur valeur est sapée par l’inflation ou si les États-Unis menacent de shut down budgétaire tous les deux ans ? Donald Trump lui-même s’est publiquement inquiété du déclin de la devise américaine en 2023, il alertait que « notre monnaie est en train de s’effondrer et ne sera bientôt plus la norme mondiale, ce qui sera notre plus grande défaite depuis 200 ans », fustigeant la perte d’influence du dollar sur la scène internationale. Ce constat, inhabituel de la part d’un dirigeant américain et surtout venant de Donald, illustre l’ampleur du risque : si le dollar venait à perdre son statut de référence, l’Amérique se retrouverait fortement vulnérable, privée de son atout géopolitique maître et contrainte de vivre selon la discipline qu’elle imposait jusqu’ici aux autres.
Or, des fissures apparaissent déjà. Les grands créanciers étrangers des États-Unis réduisent la voilure. Historiquement, des pays comme la Chine ou le Japon finançaient massivement la dette américaine en recyclant leurs excédents commerciaux dans les obligations du Trésor. En 2011, la Chine détenait ainsi près de 13 % de la dette publique américaine et le Japon 9 %. Mais plus récemment, ces parts se sont effondrées : fin 2024, la Chine ne représente plus qu’environ 2 % de la dette US et le Japon 3 %. En une décennie, la part de la dette américaine détenue par ses principaux créanciers étrangers est tombée de presque un quart à seulement 6 %. Plusieurs facteurs expliquent ce désengagement : volonté de diversification des réserves, tensions géopolitiques et moindre attrait des bons du Trésor dans un contexte de hausse des taux et d’affaiblissement du dollar. Le géant américain voit s’éroder le socle international qui soutenait sa dette, ce même socle qui lui assurait une certaine impunité financière.
Un sauveur inattendu : la crypto et les stablecoins
Face à cette situation périlleuse, une lueur d’espoir inattendue provient… du monde des cryptomonnaies. Plus précisément, des stablecoins, ces jetons numériques indexés sur le dollar. À première vue, l’idée semble paradoxale : le Bitcoin et les crypto-actifs sont nés d’une méfiance envers le dollar et le système financier centralisé. Comment pourraient-ils voler au secours de l’hégémonie du dollar et de la dette américaine ? La réponse tient dans la nature même des stablecoins : ce sont des actifs digitaux conçus pour répliquer la valeur du dollar et ils sont massivement utilisés pour les échanges sur les plateformes crypto. En d’autres termes, les stablecoins dollarisés propagent l’usage du dollar dans l’économie numérique mondiale.
Depuis 2020, les stablecoins connaissent une croissance explosive. Leur capitalisation totale dépasse désormais les 250 milliards de dollars, contre à peine quelques milliards il y a cinq ans. En l’espace de 18 mois, la valeur cumulée des principaux stablecoins a plus que doublé pour atteindre environ 280 milliards de dollars en 2025. Des projections envisagent même qu’elle pourrait franchir le cap des 2 000 milliards d’ici quelques années si la demande continue sur cette lancée. Derrière ces chiffres se cache un phénomène stratégique : quasiment tous ces stablecoins sont adossés au dollar américain. Que ce soit Tether (USDT), USD Coin (USDC) ou d’autres, plus de 99 % du marché des stablecoins reproduit la valeur du dollar. Autrement dit, alors même que certains pays cherchent à éviter le dollar, le monde des cryptos, lui, plébiscite une version numérique du billet vert.
Concrètement, un stablecoin comme l’USDT fonctionne ainsi : pour chaque jeton en circulation, la société Tether détient en face des réserves équivalentes, principalement sous forme de dollars ou de titres très liquides libellés en dollars (bons du Trésor US, certificats de dépôt, etc.). Il en va de même pour USDC émis par Circle, qui place une part importante de ses réserves en obligations du Trésor américain à court terme. C’est une donnée cruciale : pour garantir la stabilité de leur token, les émetteurs de stablecoins alimentent la demande en dette publique américaine. À titre d’illustration, cette année, les réserves en bons du Trésor détenues par Tether et Circle ont atteint un niveau supérieur à la totalité de la dette souveraine de pays comme l’Arabie saoudite. En quelques années, ces nouveaux acteurs privés de la crypto sont ainsi devenus des créanciers non négligeables des États-Unis, au même titre qu’un État étranger de premier plan. Et leur appétit ne fait que croître.
Pourquoi un tel engouement pour les stablecoins en dehors des États-Unis ? Parce qu’ils offrent les avantages du dollar via une stabilité relative, une liquidité, une acceptation mondiale, sans les frictions du système bancaire traditionnel. N’importe quel internaute, du Brésil au Nigeria, peut convertir sa monnaie locale en stablecoins via un échange crypto et ainsi protéger son pouvoir d’achat en le dollarisant sous forme numérique. Les stablecoins permettent aussi des transferts instantanés de valeur, 24h/24 et 7j/7, là où un virement international en dollars peut prendre plusieurs jours et coûter cher en frais. Dans des pays confrontés à l’inflation ou à des contrôles de capitaux, ces jetons stables en dollars sont devenus une bouée de sauvetage financière. Même pour les traders et investisseurs crypto du monde entier, c’est le moyen le plus pratique de sortir temporairement de positions risquées en restant dans l’écosystème numérique. Par exemple, un spéculateur asiatique qui vend ses bitcoins ira souvent se réfugier en USDT plutôt qu’en dollars papiers ou sur un compte bancaire, pour pouvoir réinvestir rapidement. Cela est aussi intéressant du coté français par exemple car cela n’entraine pas de taxation sur la plus-value. En effet, en échangeant un actif crypto (par exemple du bitcoin) contre un stablecoin, vous n’êtes pas redevable de la flat-tax sur les plus-values car vous n’êtes pas sorti de l’écosystème crypto.
Le résultat de cette dynamique est surprenant : les stablecoins renforcent l’emprise du dollar sur l’économie mondiale, en particulier dans sa dimension digitale. Ils agissent comme un cheval de Troie financier : chaque fois qu’un Argentin ou un Turc achète des USDT, il consolide l’usage du dollar comme monnaie de transaction et, indirectement, il finance la dette américaine en créant de la demande pour les bons du Trésor. Vu sous cet angle, les stablecoins sont une extension moderne du « privilège exorbitant » américain. Ils portent le dollar là où le système bancaire classique n’allait pas et recyclent ces dollars virtuels en dette publique des États-Unis. Une analyse menée par ARK Invest en 2025 souligne à quel point ce phénomène pourrait changer la donne : la croissance exponentielle des stablecoins au cours des cinq prochaines années pourrait engendrer une demande supplémentaire en obligations américaines comparable à celle qu’apportaient autrefois les grandes banques centrales étrangères. En d’autres termes, les utilisateurs de stablecoins dans le monde pourraient devenir les nouveaux financeurs de l’Amérique, compensant le retrait des créanciers traditionnels.
Les autorités américaines commencent d’ailleurs à prendre conscience de l’atout stratégique que représentent ces dollars numériques. Alors qu’au départ le régulateur voyait d’un œil méfiant l’essor des stablecoins (risques de blanchiment, de fraude ou d’instabilité financière), le discours évolue. Un projet de loi surnommé « Genius Act » discuté au Congrès vise à encadrer strictement les émetteurs de stablecoins, en exigeant une adossement intégral par des actifs liquides comme la monnaie centrale ou les bons du Trésor. L’objectif est double : protéger les utilisateurs en garantissant la stabilité des tokens, mais aussi intégrer ces derniers dans le giron du dollar officiel. Même certains stratèges de l’administration Trump auraient perçu l’opportunité que présentent les stablecoins pour consolider le rôle du dollar. Il est assez ironique de voir la cryptosphère, née en partie de la contestation de l’hégémonie du dollar, se muer en alliée pour prolonger cette hégémonie. Le département du Trésor, loin de bouder ces innovations, « se félicite de l’essor potentiel de la demande pour sa dette souveraine » grâce aux stablecoins. Il n’est pas fréquent de voir un État encourager indirectement l’utilisation d’une monnaie numérique privée, mais dans ce cas l’intérêt converge avec celui du secteur crypto : maintenir la suprématie du dollar comme étalon international.
Un équilibre fragile mais porteur d’espoir
Bien sûr, tout n’est pas rose dans ce tableau. La dépendance accrue aux stablecoins pose aussi des défis et des risques. D’abord, ce sont des instruments privés : si demain Tether ou Circle faisait faillite ou était victime d’une attaque, la confiance pourrait s’effondrer brutalement. Un krach des stablecoins provoquerait une onde de choc sur le marché obligataire américain si leurs réserves étaient liquidées en catastrophe. Les régulateurs soulignent également le risque systémique que représentent ces acteurs non bancaires devenus détenteurs de centaines de milliards en titres financiers. La célèbre économiste Hélène Rey a mis en garde en 2023 contre un « système monétaire parallèle intrinsèquement fragile » : selon elle, si les stablecoins continuent d’être dominés par le dollar, ils pourraient accentuer la dollarisation de certaines économies au détriment de leur stabilité, faire peser un risque de fuite des dépôts bancaires, compliquer la politique monétaire et même éroder le seigneuriage des États (car la création monétaire profiterait à des entreprises privées plutôt qu’aux banques centrales). Elle note cependant que, paradoxalement, ces mêmes stablecoins pourraient devenir « un pilier numérique renforçant le privilège du dollar » sur la scène internationale. Le défi pour les États-Unis sera donc d’encadrer ce phénomène de manière à en maximiser les bénéfices (soutien au dollar, financement de la dette) tout en minimisant les risques (instabilité financière, perte de contrôle monétaire).
D’autres voix prônent une solution plus radicale : la création par la Réserve fédérale d’un dollar numérique public. Un tel FedCoin, émis par la banque centrale elle-même, offrirait les avantages des stablecoins (transferts instantanés, accessibilité mondiale) sans les défauts de la privatisation. Les États-Unis reprendraient en main le pouvoir de création monétaire numérique et le seigneuriage qui l’accompagne. Toutefois, un dollar numérique de banque centrale fait face à des obstacles politiques (réticence vis-à-vis d’un État trop intrusif) et techniques. En attendant, ce sont bien les stablecoins du secteur privé qui mènent la danse et servent de laboratoire grandeur nature. De plus il semblerait que Trump ne soit plus du tout engagé dans une telle politique par opposition à l’idée de l’euro numérique.
Conclusion
Le destin financier des États-Unis pourrait bien se jouer à la croisée de deux mondes que tout oppose en apparence : celui des dettes et déficits publics et celui des cryptomonnaies innovantes. D’un côté, une superpuissance qui vacille sous le poids de ses engagements et voit poindre la fin de son règne monétaire. De l’autre, un écosystème numérique foisonnant qui, sans le vouloir explicitement, offre au dollar un second souffle en étendant son royaume dans le cyberspace. Les stablecoins incarnent ce point de convergence. En répandant une version numérisée du dollar aux quatre coins du globe et en transformant chaque détenteur de smartphone en potentiel investisseur indirect de la dette US, ils apportent une bouée d’oxygène à l’Oncle Sam.Bien sûr, les stablecoins ne résoudront pas à eux seuls le problème structurel d’une dette américaine en constante expansion. Néanmoins, à court et moyen terme, la crypto-monnaie stable est en passe de devenir un allié insoupçonné de la puissance américaine.
En fin de compte, si les États-Unis parviennent à naviguer prudemment entre innovation et régulation, ils pourraient transformer ce paradoxe en avantage : utiliser les stablecoins comme levier pour continuer à financer leurs besoins tout en préservant le statut du dollar. La crypto, enfant terrible de la finance, se muerait alors en pilier discret de la stabilité financière américaine. Ce scénario n’est plus de la science-fiction économique : il se joue dès à présent, transaction après transaction, dans le vaste théâtre numérique des blockchains.
.png)